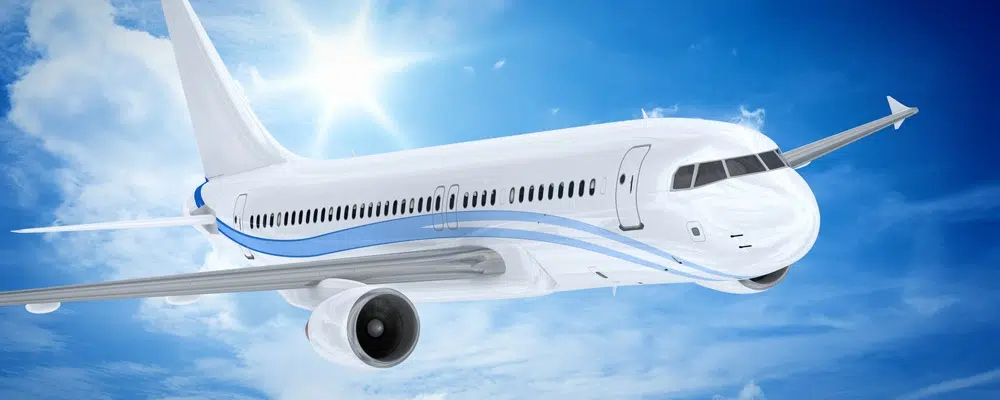Un fait s’impose : aucun inventaire public n’expose l’intégralité des textes qui ont servi à bâtir ChatGPT. Les données dont nous disposons proviennent de fragments révélés par OpenAI et de travaux d’observation extérieurs. Les contenus soumis au droit d’auteur n’échappent pas forcément à cette collecte, sans que leurs créateurs en aient été systématiquement informés.
OpenAI écarte volontairement certaines sources, notamment tout ce qui relève de l’intime ou du confidentiel, dans le respect de sa politique de confidentialité. Les modalités de sélection évoluent au fil du temps et des législations, ce qui rend la cartographie précise du corpus d’entraînement quasiment impossible.
Comprendre l’origine des données de ChatGPT : un panorama accessible
ChatGPT n’a rien d’un miracle tombé du ciel. Derrière ce chatbot, il y a un chantier titanesque : des données extraites, triées, enrichies, venues des coins les plus divers du web, de bibliothèques numériques et de contributions humaines. La collecte s’organise sous la houlette d’OpenAI, une entreprise fondée par Sam Altman et Elon Musk, qui orchestre depuis le début la construction des modèles GPT.
Plusieurs jeux de données majeurs forment l’ossature de ce système : Common Crawl pour l’aspiration massive de pages web, WebText2 pour sa sélection qualitative, les corpus Books 1 et Books 2 pour la richesse littéraire, et Wikipedia pour la dimension encyclopédique. Ces ressources irriguent le moteur de l’intelligence artificielle et lui permettent de jouer avec le langage, de générer du texte et de tenir la conversation sur des sujets variés. Les générations successives, GPT-3, GPT-3.5, GPT-4, GPT-4o, ne cessent d’élargir le champ, intégrant le renforcement par apprentissage, et, pour certains usages, la génération d’images via DALL·E 3.
Pour intégrer des informations protégées, OpenAI et Microsoft ont noué des partenariats avec plusieurs grands médias : Le Monde, Prisa Media, Associated Press, Financial Times, Axel Springer, Reuters, AFP, News Corp. Ainsi, ChatGPT agent conversationnel puise à la fois dans des textes accessibles à tous, dans des livres, des encyclopédies, mais aussi dans des productions journalistiques sous licence. À ce socle s’ajoutent les ajustements issus de la modération humaine et des interactions avec les utilisateurs, qui affinent les réponses du modèle.
Aujourd’hui, ChatGPT s’impose comme un modèle d’IA linguistique situé à la croisée de la technique et des enjeux de société, bâti sur un assemblage de sources hétérogènes dont la transparence reste un défi permanent.
D’où proviennent réellement les informations utilisées par ChatGPT ?
L’architecture de ChatGPT repose sur la diversité de ses données d’entraînement. Pour façonner ce modèle, OpenAI a rassemblé une masse impressionnante de textes issus de plusieurs univers. Au premier plan : Common Crawl, une archive monumentale du web, avec des pages, des forums, des articles, tout ce que le web public peut offrir. D’autres sources structurées prennent le relais : WebText2, Books 1 et Books 2, qui totalisent plusieurs millions d’ouvrages numérisés, et Wikipedia, pour sa richesse linguistique et encyclopédique.
Voici quelques exemples parmi les principaux piliers de cette architecture :
- Common Crawl : récupération automatique de pages web accessibles à tous
- WebText2 : sélection de textes présentant une rédaction aboutie
- Books 1 & 2 : œuvres littéraires numérisées de toutes sortes
- Wikipedia : articles encyclopédiques dans de nombreuses langues
Mais la mosaïque de données ne s’arrête pas à ce qui est public. ChatGPT apprend aussi de l’usage, en s’appuyant sur les questions posées par les utilisateurs et sur les corrections apportées par des équipes de modération humaine, qui visent à améliorer la pertinence des réponses et à limiter les biais.
Pour accéder à des contenus journalistiques protégés, OpenAI et Microsoft ont misé sur des accords passés avec des groupes de presse majeurs : Le Monde, Reuters, Associated Press, Financial Times, Axel Springer, AFP, News Corp, Prisa Media. Grâce à ces partenariats, le modèle gagne en actualité et en diversité d’analyse.
C’est la combinaison de ces ensembles qui donne à ChatGPT la capacité de générer du texte, de répondre à des questions diverses et de s’adapter à des usages variés, qu’il s’agisse de création rédactionnelle ou d’assistance technique.
Enjeux éthiques et questions de transparence autour des données d’entraînement
Le débat sur la transparence à propos des sources utilisées pour entraîner ChatGPT, conçu par OpenAI, s’intensifie. Des organisations comme la Mozilla Foundation critiquent une opacité persistante sur la composition précise des jeux de données, notamment ceux issus de Common Crawl. Puiser massivement dans des contenus du web sans contrôle préalable expose le chatbot à des risques : biais implicites, stéréotypes, conflits de droit d’auteur ou d’attribution des contenus.
La protection des données personnelles préoccupe tout particulièrement. Des collectifs tels que Noyb, menés par Maartje de Graaf, pointent que l’aspiration automatique peut capter des informations sensibles, soulevant des questions sur le respect de la vie privée. Ce sujet agite les régulateurs, et l’Union européenne reste en alerte sur la conformité des pratiques au RGPD. D’ailleurs, l’actualité judiciaire est là pour le rappeler : le New York Times a engagé des poursuites contre OpenAI, accusant l’entreprise d’avoir utilisé ses contenus sans autorisation.
Autre sujet d’inquiétude : l’apparition de hallucinations, ces réponses erronées produites par l’IA, et la diffusion possible de fausses informations. Les critiques convergent sur un point : l’absence de garanties sur l’origine, la qualité et la fiabilité des données attise la méfiance, fragilise la confiance envers le chatbot et, plus largement, dans l’ensemble des modèles génératifs.
Quelles alternatives et perspectives pour une intelligence artificielle plus responsable ?
Le paysage de l’intelligence artificielle générative ne se limite pas à ChatGPT. D’autres initiatives se font entendre, avec pour objectif affiché : renforcer la transparence, respecter les droits d’auteur et réduire les biais. Les modèles proposés par Anthropic (Claude 2, Claude 3) ou par MistralAI (Le Chat) explorent de nouvelles méthodes. Leur communication s’appuie sur une gouvernance éthique : description détaillée des jeux de données, validation humaine accrue, dispositifs de contrôle pour limiter les dérives.
Le rôle du travail humain dans la supervision des réponses générées prend de l’ampleur. Certaines démarches privilégient l’expertise, les corpus validés et l’implication d’acteurs externes, renforçant ainsi la robustesse et la légitimité des modèles. Cette orientation se traduit par la publication de rapports d’audit, un dialogue avec la société civile et une volonté affichée de sortir du secret industriel qui a longtemps prévalu dans le secteur.
L’innovation technique ne saurait suffire. Pour bâtir une intelligence artificielle responsable, il s’agit aussi de garantir un accès ouvert, tout en veillant à la reconnaissance des créateurs de contenus. Les accords conclus entre OpenAI, Microsoft et de grandes rédactions comme Le Monde, News Corp, AFP ou Reuters esquissent un nouveau modèle : licence, partage de la valeur, reconnaissance du travail journalistique. En s’appuyant sur ce socle, les alternatives à ChatGPT tracent une voie vers une intelligence artificielle à la fois plus fiable et plus démocratique.
À mesure que la technologie progresse, la question de la provenance des données devient un test de confiance. Demain, les voix qui comptent seront sans doute celles capables de dire d’où elles parlent et sur quelles bases elles se construisent.