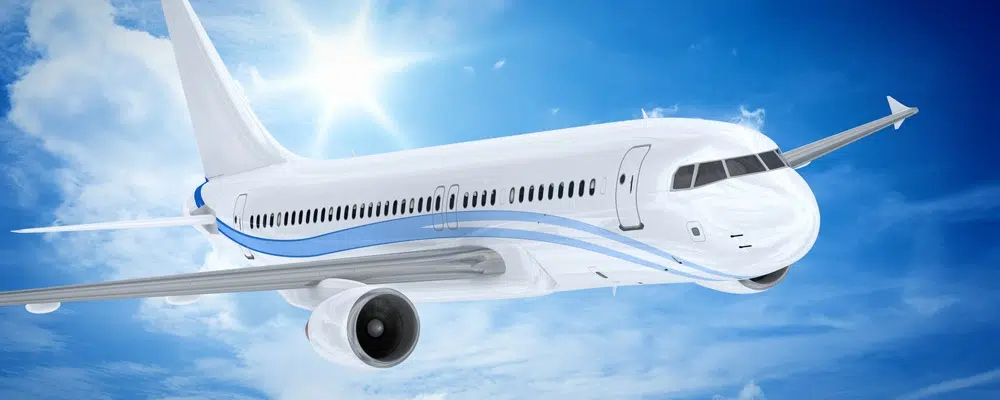1 222 kilomètres de frontière, des législations qui s’entrechoquent et un marché qui ne ressemble à aucun autre : acheter une maison au Canada, pour un Français, c’est naviguer entre opportunités et chausse-trapes. Un parcours où chaque province pose ses propres jalons et où la règle change dès qu’on franchit une rivière ou une autoroute.
Dans certaines provinces, impossible de passer à côté d’une taxe spéciale pour les acheteurs étrangers. D’autres, au contraire, déroulent le tapis rouge aux nouveaux résidents permanents. Pour obtenir un prêt hypothécaire, les non-résidents devront souvent prouver leur sérieux avec un apport nettement plus élevé que celui demandé aux Canadiens. Les exigences ne s’arrêtent pas là : chaque dossier doit s’adapter à des règles de traitement variables selon la région. L’envoi d’argent depuis l’étranger ou l’absence d’historique de crédit local peut facilement étirer les délais administratifs.
Ce qu’il faut savoir avant d’acheter une maison au Canada en tant que Français
Se lancer dans l’achat d’une propriété au Canada revient à accepter un jeu de règles mouvantes, dépendant de votre statut de résidence. Un Français vivant à l’étranger ou nouvellement arrivé peut tout à fait acquérir une maison, mais sous conditions : restrictions fiscales, démarches supplémentaires, formalités propres à chaque province. L’Ontario et la Colombie-Britannique, par exemple, imposent une surtaxe pouvant grimper jusqu’à 20 % du prix du bien. Cette charge, loin d’être anecdotique, s’ajoute à l’addition finale.
Du côté des banques, le non-résident doit se préparer à sortir le grand jeu : l’apport personnel exigé se situe entre 20 et 35 %. Là où un Canadien pourrait miser sur 5 %, un expatrié doit rassurer avec des preuves solides de revenus et d’emploi, ou un dossier de crédit irréprochable, même si ce dernier n’est pas toujours évident à construire depuis l’étranger.
Obtenir le statut de résident permanent ouvre certaines portes : accès élargi au crédit, exemptions de taxes dans plusieurs provinces, démarches simplifiées. Mais la question fiscale, elle, ne se dissipe jamais. Résidence principale ou investissement locatif ? Chaque option entraîne des règles distinctes, aussi bien pour la déclaration des revenus que pour la revente.
Voici l’essentiel à anticiper pour éviter les mauvaises surprises :
- Renseignez-vous précisément sur votre capacité à acheter dans la province de votre choix, car les critères changent d’une région à l’autre.
- Préparez à l’avance tous les justificatifs bancaires, fiches de paie, attestations de revenus ou relevés de compte.
- Calculez minutieusement votre budget en tenant compte des taxes, droits et frais réservés aux non-résidents.
Dans cette jungle réglementaire, un courtier immobilier local, francophone de préférence, saura éviter les pièges. Il accompagne, conseille, et, surtout, connaît les astuces pour monter un dossier sans faille.
Quelles différences entre les provinces et quelles lois pour les non-résidents ?
Le Canada ne parle jamais d’une seule voix sur le plan immobilier. À Vancouver et Toronto, difficile d’échapper à cette taxe de 20 % qui vise les acheteurs étrangers et tente de freiner la flambée des prix. Au Québec, le climat est plus clément : pas de surtaxe, mais des frais de mutation à ne pas négliger. En Alberta, la porte est grande ouverte, aucune restriction provinciale n’est imposée.
Depuis 2023, la législation fédérale interdit aux non-résidents d’acheter certains types de propriétés, avec des exceptions notables : permis de travail, statut de réfugié, mariage avec un citoyen canadien. Les terrains vacants ou les immeubles de grande taille ne sont pas concernés, et certaines régions rurales échappent aussi à ce verrou.
| Province | Taxe sur les étrangers | Spécificités |
|---|---|---|
| Ontario | 20 % | Toronto, Golden Horseshoe |
| Colombie-Britannique | 20 % | Vancouver, Victoria |
| Québec | Non | Frais de mutation |
| Alberta | Non | Aucune restriction provinciale |
Le parcours varie : le lieu, votre statut, la destination du bien (habitation ou location) déterminent les démarches. À Toronto ou Vancouver, la vigilance s’impose sur chaque taxe. À Montréal ou Calgary, le jeu s’avère moins corseté. Chaque région impose ses propres règles pour le crédit, la fiscalité ou encore l’enregistrement du bien. Dans ce puzzle législatif, mieux vaut analyser chaque marché local en détail avant de s’engager.
Le parcours d’achat étape par étape : du financement à la remise des clés
Pour avancer, la première étape consiste à obtenir une préapprobation hypothécaire auprès d’un établissement financier canadien. Sans ce précieux sésame, impossible d’enchâsser la suite. La banque exigera une mise de fonds souvent comprise entre 20 % et 35 %, s’appuyant sur vos justificatifs de revenus et la solidité du dossier de crédit. Le taux d’intérêt proposé dépendra de ce diagnostic.
La recherche du bien se fait généralement avec un courtier, qui mettra à disposition toutes les données utiles : fiche détaillée, historique du vendeur, estimation municipale. L’offre d’achat, pour être prise au sérieux, inclut souvent une clause d’inspection. Entre l’inspection, les honoraires du notaire, les droits de mutation et la fameuse « taxe de bienvenue », les frais annexes peuvent rapidement s’accumuler. L’assurance habitation, quant à elle, reste obligatoire avant de recevoir les clés.
Une fois l’achat conclu, il faut enregistrer la propriété auprès des instances provinciales. Ce passage officialise la transaction et déclenche le paiement des frais de clôture. Penser à anticiper le transfert des contrats d’énergie ou d’eau garantit un emménagement sans accroc. Pour le transfert de fonds, des plateformes spécialisées comme Wise permettent de limiter les frais bancaires et d’accélérer les démarches. Chaque étape, du montage financier à la signature finale, réclame attention et méthode.
Réponses aux questions fréquentes et conseils pratiques pour expatriés
Non-résident : quelles démarches spécifiques ?
Les Français qui s’installent au Canada veulent souvent savoir s’ils peuvent acheter. La réponse est oui, sous réserve de respecter les règles de la Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens. Les exceptions existent : permis de travail, statut de réfugié, ou vie maritale avec un citoyen canadien. En Ontario ou en Colombie-Britannique, la taxe de 20 % sur le prix d’achat s’applique en plus du montant du bien.
Quels justificatifs fournir ?
Il est indispensable de monter un dossier de crédit solide ou, au moins, de prouver son sérieux avec des documents de paiement. Les banques demanderont systématiquement des preuves de revenus et d’emploi, ainsi qu’un apport conséquent : prévoyez entre 20 et 35 % du prix de vente. La préapprobation hypothécaire, obtenue en amont, facilite tout le processus.
Gestion locative et fiscalité
Si l’objectif est la location, il est judicieux de confier la gestion à une agence spécialisée. Les loyers perçus doivent être déclarés au fisc canadien, tandis qu’une plus-value à la revente déclenchera l’imposition sur les gains en capital.
Voici quelques pratiques pour éviter les écueils courants :
- Appuyez-vous sur un guide d’achat local pour maîtriser les démarches spécifiques.
- Pour transférer vos fonds, un service comme Wise offre souvent une alternative moins coûteuse aux banques traditionnelles.
Entre la diversité des lois, la variation des frais et la nécessité d’anticiper chaque étape, réussir son projet immobilier au Canada, c’est avant tout rester informé, bien accompagné et prêt à rebondir à chaque imprévu.